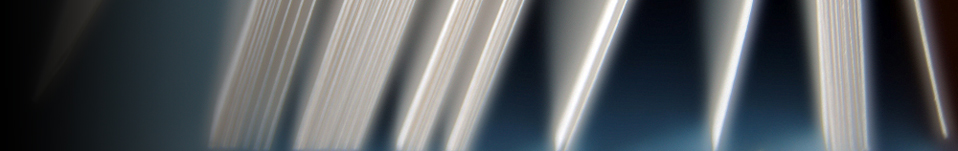Henri Atlan
Quelques extraits de l’entretien avec Henri Atlan en 2004
Henri Atlan est professeur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ; il a enseigné aux facultés de médecine de l’université de Paris et de Jérusalem. Ses travaux scientifiques ont contribué au renouvellement des connaissances biologiques contemporaines, notamment l’organisation biologique et la théorie d’information
AS : Je voudrais maintenant aborder la question des soins palliatifs. Ils se sont développés en France à l’époque où s’est créée l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD). Je me demande si la création de soins palliatifs animés principalement par des catholiques n’a pas été la réponse aux laïcs qui fondaient l’ADMD.
HA : Cela s’est peut-être passé ainsi en France, mais à ma connaissance les soins palliatifs ont commencé bien plus tôt en Grande Bretagne sous la forme de soins prodigués à domicile. Le noyau dur des soins palliatifs c’est la lutte contre la douleur ; cette volonté là s’est heurtée à une longue tradition chrétienne de valorisation de la douleur. Aujourd’hui, cette théorie de la douleur rédemptrice est abandonnée par l’Eglise. Je crois que les soins palliatifs se sont imposés quand la lutte contre la douleur a été vécue comme légitime ; il ne s’agit pas seulement des fins de vie mais aussi, par exemple, de la douleur post-opératoire. L’utilisation de la morphine a longtemps été taboue.
L’ADMD s’est créée à propos de l’euthanasie, de la lutte contre l’acharnement thérapeutique. Malheureusement, la confusion s’est établie très vite entre non acharnement thérapeutique et euthanasie. L’ADMD s’est fondée selon le principe : chacun a le droit de décider pour lui tout seul quand et comment il va mourir. Selon cette association le suicide assisté doit être légalisé (même pour une personne en bonne santé), certaines formes d’euthanasie aussi .Mais la volonté de mourir n’est pas la même lorsque la maladie est envisagée et lorsque la maladie est là
AS : Je voudrais passer à un autre sujet d’éthique, celui des cellules souches embryonnaires. Le 28 novembre 2004, les Suisses se sont prononcés par référendum à 66% pour l’exploitation à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires.
HA : Je participais une semaine plus tôt à un colloque à Genève sur ce même sujet sous l’égide de la fondation Wright. Il se trouve que la Suisse avait déjà voté, il y a plusieurs années, au sujet des embryons surnuméraires de la fécondation in vitro : la décision préconisait qu’il ne soit plus produit d’embryons surnuméraires et on proposait que ceux qui existaient déjà soient détruits en décembre 2004. Le référendum a été proposé juste avant cette échéance de décembre 2004. Les biologistes souhaitaient que ces embryons surnuméraires servent à fabriquer des cellules souches embryonnaires. La réponse a été oui, ce qui a heureusement évité que le législateur soit dans une insoluble contradiction.
AS : La perspective était la recherche médicale en vue de nouveaux protocoles thérapeutiques. Aux USA, Bush veut l’interdire. En France, l’interdiction a été prononcée dans l’attente de la mise en place d’une structure qui permette de décider dans quel cas on peut utiliser ces cellules souches
HA : En France, la seule possibilité est d’importer les cellules souches à partir de pays dans lesquels des lignées ont déjà été développées, par exemple la Grande Bretagne ou la Belgique.
AS : Ces lignées ont bien été établies à partir d’embryons. On peut les importer en France, mais on ne peut les fabriquer à partir d’embryons.
HA : Ces embryons sont de toute façon destinés à mourir. Ils seront décongelés et vont mourir. Pourquoi ne pas prélever des cellules sur eux alors qu’on autorise dans le cas d’une vraie personne avec toute sa dignité qui vient de mourir les prélèvements d’organes ? Même si on pense que les embryons ont une dignité, on devrait autoriser ces prélèvements de cellules.
AS : Alors pourquoi en France est-il interdit d’utiliser les embryons surnuméraires ?
HA : Si on considère l’embryon comme une personne humaine réelle depuis sa fécondation, on ne doit pas utiliser une personne comme moyen sans : selon un principe kantien attenter à sa dignité. C’est la position soutenue par l’Eglise catholique qui, pour la même raison, interdit tout avortement quel qu’en soit le moment.
AS : L’Eglise catholique a perdu la partie sur le sujet de l’avortement depuis que la loi Veil a fait consensus, mais elle semble être influente au-delà de ses fidèles sur cette question des embryons. Il y a l’idée que l’embryon est un être potentiel.
HA C’est le comité national d’éthique qui a émis cette idée, source de confusion.. Elle n’est pas géniale sur le plan philosophique, mais sur un plan juridique elle a été utile. Il s’agissait de se demander si on a le droit d’utiliser les produits d’avortement (destinés donc à être simplement jetés) pour faire de la recherche ou des greffes de cellules embryonnaires. Certains ont craint un abus consistant à faire des avortements délibérément dans ce but. De là est venue la réflexion sur le statut de l’embryon. La polémique a été relancée entre ceux qui considéraient l’embryon comme une personne réelle et ceux qui disaient ce sont des amas de cellules. Le problème a été posé avec force à l’occasion d’un scandale au début des années 80 : des camions remplis d’embryons réfrigérés étaient transportés vers l’Allemagne dans le but de fabriquer des cosmétiques. Ceux qui disaient que l’embryon n’était pas une personne étaient d’accord pour exclure ce type d’utilisation. Alors a été avancée la notion de potentialité qui est réelle au plan biologique. On a alors dit que l’embryon doit être considéré comme une personne humaine potentielle. Ainsi on pouvait autoriser les utilisations dans un but noble comme la recherche ou la thérapeutique. Cette expression a eu un succès dans le monde entier !
AS : N’est-ce pas une démarche du même type qui a conduit à faire une différence fondamentale entre clonage thérapeutique et clonage reproductif ? Le clonage reproductif est une transgression par rapport à la notion de parentalité. En revanche, le fait d’utiliser des cellules souches pour soigner serait fondé.
HA : Dans le cas du clonage thérapeutique, on n’a pas affaire à des embryons. Lorsqu’on fait un transfert d’un noyau dans un ovule énuclée on fabrique une construction de cellules artificielles qui n’est pas un embryon. Ce que nous proposons, notamment avec Mireille Delmas Marty, c’est de réserver le nom d’embryon à des cellules qui pourraient se développer comme les embryons, à condition d’être implantées dans un utérus. C’est l’implantation utérine qui qualifie les cellules d’embryons.
AS : Rappelez-nous pourquoi vous êtes opposé au clonage reproductif ?
HA : Ce serait une expérimentation sur des femmes et sur de futurs enfants dans des conditions totalement inadmissibles pour toutes les conventions internationales concernant l’expérimentation humaine. Il est impensable de faire sur des femmes des expériences qui ne marchent pas sur les animaux, car cela conduirait par exemple à exposer ces femmes à des avortements à répétition, à risquer de fabriquer des enfants anormaux. Même si, au niveau philosophique, on accepte l’idée du clonage reproductif, en l’état actuel de la technique ce serait criminel.
AS : Est-ce qu’on n’a pas de bons résultats pour les animaux clonés ? La brebis Dolly fut"réussie".
HA : On l’a tuée parce qu’elle commençait à vieillir. Il faut savoir que pour une brebis Dolly présentable il a fallu faire plus de 270 essais qui avaient des anomalies. Si on transpose cela à l’espèce humaine, on s’exposera à une proportion d’échecs comparable sur des femmes. Personne ne peut envisager cela.
AS : Mais lorsqu’on dominera la technique, la question se poserait au seul niveau philosophique.
HA : A ce moment-là, la question ne serait plus biologique et il faudrait se demander pourquoi on veut faire du clonage reproductif. On trouvera que dans l’immense majorité des cas les motivations sont complètement fantasmatiques : il s’agit de faire des gens identiques.
AS : Le clonage reproductif devra donc être écarté pour des raisons morales.
HA : La loi française l’écarte en invoquant la notion de crime contre l’espèce humaine. C’est absurde d’être aussi absolu. Ce ne serait pas un crime, mais à coup sûr on va créer des problèmes difficiles pour cet enfant ; on ne peut pas dire pour autant que le clonage reproductif créera des monstres qui n’appartiendraient pas à l’espèce humaine. Un expert auprès du comité d’éthique des Etats-Unis avec qui je suis d’accord a dit que le clonage reproductif serait une offense à la dignité humaine, mais qu’il n’y aurait aucune diminution de dignité dans les produits qui pourraient en résulter.
AS : Vous n’aimez pas le terme de clonage thérapeutique. Il s’agit de transférer un noyau dans un ovule énuclée.
HA : A partir de cela, on fabrique des cellules souches qui ont les propriétés des cellules souches embryonnaires . C’est comme si on les avait produits par fécondation in vitro.
AS : Vous pensez donc que l’Eglise catholique devrait admettre cette technique thérapeutique. Pourtant il y a même des chercheurs pour rejeter cette démarche, par exemple Axel Kahn.
HA : Il est le seul. Il considère non pas que c’est condamnable en soi, mais seulement que c’est une pente glissante vers le clonage reproductif. Personnellement, je pense que c’est faux. Les deux choses sont très distinctes. Pour moi, le résultat de ce"clonage thérapeutique" est un outil extraordinaire pour la recherche fondamentale, pour étudier les mécanismes du développement embryonnaire qu’on connaît si mal.
AS : Comment avez-vous progressivement articulé votre compétence biologique avec une compétence philosophique ?
HA : Il ne s’agit pas d’un savoir mais plutôt d’une réflexion que j’ai dû mener du fait de mon appartenance au Comité national d’éthique pendant dix-sept ans.
AS : Si on vous a proposé au CNE, c’est que votre formation de biologiste de haut niveau se doublait d’un souci philosophique plutôt exceptionnel.
HA : En effet j’étais un biologiste qui, par certains de ses écrits, avait témoigné de quelque intérêt philosophique. C’était en 1983. Mais je n’avais pas de solutions à proposer à ce moment-là. C’est le CNE qui m’a incité à réfléchir à des questions nouvelles pour moi, par exemple celle des mères porteuses.
AS : Dans cette période, avez-vous été amené à lutter contre la domination croissante de la génétique sur l’ensemble de la pensée du biologique ?
HA : C’est vrai qu’alors la biologie a été dominée par une génétique très réductrice. La biologie était réduite au dogme du programme génétique écrit dans les séquences d’ADN. Ma réticence à cette conception n’était pas seulement philosophique, elle me semblait abusive, d’abord au niveau biologique elle diffusait l’idée fausse que tout est écrit dans les gènes.
AS : Puis il y a eu des découvertes qui ont contredit cette hypothèse totalisante du tout génétique.
HA : Les ADN ne fonctionnent pas comme un programme d’ordinateur linéaire fondé sur un raisonnement strictement déductif. Les gènes ont des effets dans la mesure où ils sont actifs ; ce caractère actif ou non actif dépend d’interactions diverses avec d’autres gènes, avec des protéines, avec l’environnement physico-chimique de la cellule.
AS : Considérez-vous qu’au-delà de ces facteurs biologiques intervient aussi l’environnement social ?
HA : Entre les dispositions génétiques et l’environnement social entre en ligne de compte un grand nombre de niveaux biologiques, par exemple les autres gènes du même chromosome, le rôle du noyau, puis le cytoplasme de la cellule, puis les cellules voisines susceptibles d’envoyer des signaux, etc. A chaque niveau, des éléments peuvent favoriser ou défavoriser l’activité d’un gène. C’est seulement après tout cela qu’on peut évoquer l’environnement physique (par exemple le climat) et l’environnement psychologique ou social.
AS : Pour vous, en l’état actuel de la connaissance des déterminismes biologiques, peut-on parler de déterminisme social comme le propose Spinoza, ou croyez-vous au libre arbitre ?
HA : Je ne crois pas au libre arbitre, mais je ne crois pas qu’un jour la science parviendra à expliquer tous les déterminismes ; la découverte scientifique de tous les déterminismes est une entreprise infinie qui progresse de façon infime. Les progrès des connaissances scientifiques nous font découvrir de plus en plus de situations déterminées là où nous croyions qu’elles étaient le fruit de notre libre arbitre. Le domaine du libre arbitre se rétrécit au fur et à mesure des découvertes scientifiques.
AS : Ne pas croire au libre arbitre est donc un pari.
HA : L’inverse l’est au moins autant. On suppose qu’il y aurait à l’intérieur même de l’homme une espèce de volonté dont on ne saurait pas dire d’où elle vient (si on savait d’où elle vient, il y aurait détermination) qui lui permettrait de créer à partir de zéro des chaînes causales dans l’univers physique, pari encore plus incroyable que le mien.
AS : Comment expliquez-vous alors la force de cette idée selon laquelle nous sommes doués d’un libre arbitre ?
HA : Elle vient tout simplement de l’expérience quotidienne des choix que nous faisons. Nous attribuons au libre arbitre notre méconnaissance des déterminismes, mais nous ne faisons jamais l’expérience du libre arbitre.
AS : Vous dites la même chose du hasard qui, selon vous, cache des déterminismes que nous ignorons.
HA : Le hasard peut être formalisé par la théorie des probabilités, ce qui permet de réintroduire un déterminisme statistique.
AS : Ne risquez vous pas d’être mécaniste, en réduisant le comportement humain à des phénomènes physico-chimiques ?
HA : Je suis mécaniste ; Spinoza explique, lui aussi, de façon mécaniste, pourquoi par exemple quelqu’un est sympathique pour quelqu’un d’autre : il s’est créé des associations dans les rencontres entre ces deux personnes telles que pour une de ces deux personnes la rencontre avec l’autre est associée à une source de joie. C’est cela qui entraîne une attraction, un amour comme il est dit. Aujourd’hui, on peut, grâce à la neurophysiologie, à l’endocrinologie, prendre en compte des substrats chimiques qui agissent sur certaines régions du cerveau. Ces mécanismes sont encore mal connus ; pour moi, le fait qu’ils existent ne dévalorise en aucune façon l’amour ; on sait qu’on peut déclencher un état comparable à l’extase mystique avec des champignons hallucinogènes ou du LSD ; cela ne dévalorise pas l’extase mystique pour autant.
AS : Dans votre dernier livre, vous parlez d’"éthique du déterminisme". Qu’entendez-vous par là ?
HA : Contrairement à une idée reçue fausse, le fait qu’on a accepté l’idée que nos choix ne sont pas libres, ne veut pas dire qu’il n’y a plus d’éthique possible. Il existe, depuis l’Antiquité, des morales déterministes, à commencer par les stoïciens et à continuer plus récemment par Spinoza. Le domaine de l’éthique est spécifique à l’espèce humaine ; il est donc très difficile à réduire à la connaissance de la biologie que nous pouvons avoir à partir d’une biologie qui est essentiellement animale Le premier niveau de l’éthique c’est le niveau plaisir-douleur qui existe chez certains animaux et chez les bébés. Mais ni les animaux ni les bébés n’ont pour autant le sens du bien et du mal. Pourtant, il y a un passage entre le plaisir et ce qui me fait du bien d’une part et entre douleur et ce me fait souffrir d’autre part. Ce passage est lié aux capacités cognitives humaines qu’on ne trouve pas chez les animaux : une mémoire beaucoup plus développée et l’imagination. A partir de là, l’expérience du plaisir et de la douleur est complètement transformée ; elle va être projetée dans le temps et dans l’espace. C’est une projection imaginative sur l’autre dans le futur. Je peux imaginer ce que ferait à moi-même ou à un autre plus tard, ce qui me fait du bien maintenant : soit du bien aussi, soit du mal A partir de ces jugements contradictoires sur ce qui fait du bien et ce qui fait du mal s’élaborent des jugements de portée générale.
AS : Cette élaboration est un acte collectif social et constitue donc votre deuxième niveau.
HA : L’avantage théorique du plaisir et de la douleur au premier niveau de l’éthique c’est que les effets de la perception sont immédiats. Quand je constate que quelque chose me fait du mal, je vais l’éviter. Mais quand il s’agit d’un jugement moral on peut juger qu’un comportement est bien moralement sans pour autant le désirer. Toutes ces constructions de la morale ne sont pas universelles ; elles dépendent des conditions socioculturelles et ont pour effet de moduler, de différer la satisfaction du désir.
AS : C’est au troisième niveau qu’on atteint l’universel.
HA : Est-ce qu’on ne pourrait pas imaginer, grâce à la raison, de décider ce qui est bien et ce qui est mal pour tout le monde ? C’est là le but que ce sont assignés depuis toujours les philosophes. L’ennui c’est que concrètement ça ne marche pas puisqu’il y a plusieurs philosophies qui prétendent chacune à l’universalité. C’est un peu comme le monothéisme. Il y a plusieurs monothéismes et chacun d’entre eux prétend à l’unicité. Concrètement, il existe des sociétés différentes avec des normes différentes.
AS : C’est en surmontant ces différences qu’on atteindra votre quatrième niveau que vous appelez méta-éthique ?
HA : Cette méta-éthique permettant à des sociétés différentes de vivre ensemble est à construire, de bas en haut, par confrontation.
AS : La déclaration universelle des droits de l’homme, historiquement élaborée à partir de plusieurs systèmes de pensée, est-elle pour vous de l’ordre de la méta-éthique ?
HA : En effet ; elle n’est pas sortie de la tête d’un philosophe surdoué. Elle a pris naissance dans un pays, la France, au sein de son assemblée nationale. Plus tard, au prix de beaucoup de modifications et de compromis, elle a été admise par une assemblée des nations. C’est un bon exemple de construction de bas en haut.
AS : Lorsque vous évoquez l’existence de Dieu, vous dites que le seul discours non idolâtre sur Dieu est un discours athée. Cela mérite explication !
HA : Le mot Dieu vient de theos qui vient de Zeus. Je trouve très raisonnable qu’on soit polythéiste ; il existe dans la nature et autour de nous des forces qui déterminent des choses qui en déterminent d’autres ; il est assez logique de nommer "dieux" ces forces. A ce premier stade, je suis polythéiste. Après, on peut concevoir une unité de la nature. Elle conduit au panthéisme. Je suis panthéiste comme Spinoza. Dieu est la totalité infinie de tout ce qui existe. C’est pour cela que la preuve de l’existence de Dieu est une tautologie.
AS : Votre prochain livre s’appelle UA, l’utérus artificiel. S’agit-il de science fiction sur la prolongation de la fécondation in vitro ?
HA : Il s’agit de ce qui se passera dans les sociétés humaines quand l’utérus artificiel permettra de faire naître les bébés en dehors du ventre des femmes. Il y a déjà quelques chercheurs qui se sont engagés sur cette voie. Il n’y a pas d’obstacle fondamental à la réalisation d’une telle machine. Il est pratiquement certain que ça existera, probablement pas avant une cinquantaine d’années. J’essaie d’analyser les conséquences sociales et culturelles qui en résulteront.
AS : On peut supposer un nouveau changement de la situation sociale des femmes.
HA : Au XX ème siècle, la pilule contraceptive a créé les conditions de l’émancipation féminine. L’utérus artificiel achèvera le processus en créant une égalité parfaite entre les deux sexes pour ce qui concerne leur participation à la procréation. L’inégalité qui subsiste aujourd’hui du fait que la femme porte le futur enfant, est ressentie par certaines comme une source d’exploitation et par d’autres comme une supériorité. Contrairement à d’autres techniques, cette technique ne pourra pas être arrêtée parce qu’elle correspondra à la décision d’une partie importante des femmes qui voudront bénéficier de ce moyen de libération.