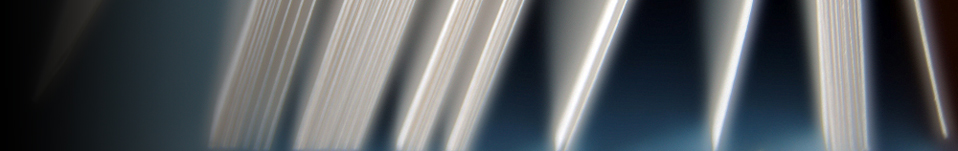Barbara Hendricks

(octobre 2003) Opéra, jazz, aparteid
Quelques extraits d’un entretien avec Barbara Hendricks
Barbara Hendricks est née dans le Sud des Etats Unis, en Arkansas. Enfant, elle a été très marquée par l’ atmosphère de ségrégation qui y régnait Aujourd’hui,star universelle, cette exceptionelle cantatrice noire est devenue ambassadrice auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
Vous êtes née dans le Sud des Etats Unis, en Arkansas. A l’époque de vos 14 ans, se développait l’action de Martin Luther King, pasteur pacifiste comme votre père. Vous souvenez vous des grandes marches ? Ressentiez-vous une atmosphère tendue ?
Mon père y a participé, mais il nous interdisait de l’accompagner : notre place était à la maison et à l’école. Mais, même en n’étant que spectatrice, j’ avais le sentiment, d’un grand mouvement qui laisserait une trace.
Depuis quand a-t-on découvert votre voix exceptionnelle, votre contre-ut ?
Quand j’avais dix ans, j’ai joué dans un petit spectacle à l’école et mon professeur a remarqué que j’avais une voix différente des autres. Deux ans plus tard, j’ai pu aller dans le groupe des grands de la chorale qui avait besoin de renfort en soprano.
Vous avez dit de cette époque que vous ne pouviez rêver de devenir cantatrice parce que vous ne saviez pas que ce loisir que vous aimiez était aussi un métier.
Cela n’existait pas pour moi. Je connaissais les enregistrements de Marian Anderson, cette "black diva" contre-alto, mais je n’avais aucune idée de l’interprétation de la musique classique comme une carrière professionnelle. J’aimais les mathématiques et je voulais étudier les sciences physiques qui étaient proches des mathématiques. Hélas, dans l’école de notre communauté méthodiste que je fréquentais, seul existait le cursus de chimie. Je l’ai donc suivi pendant deux ans avant d’entrer à l’université grâce à une bourse d’étude. Lorsque j’ai achevé ma troisième année, une dame qui m’avait entendue chanter à l’université et à l’église m’a demandé de venir chanter devant Monsieur Richard Smith. Il m’a demandé si j’accepterais une bourse pour un stage de neuf semaines à Osborn.
Vous avez alors pour la première fois étudié sérieusement la musique, le répertoire classique.
C’était une nouvelle planète pour moi, même si j’avais quelquefois regardé des concerts à la télévision et si j’avais à la maison quelques disques, dont un de Leontyne Price. A Osborn, brusquement, j’étais entourée de musique. De ma chambre, j’entendais dès le matin les flûtistes ou les violonistes travailler leur instrument. Là où je travaillais moi-même, je côtoyais les pianistes.
Après cela vous êtes quand même revenue à l’université pour la dernière année de préparation d’un diplôme de chimie.
Oui, mais alors mes professeurs m’ont soutenue avec enthousiasme. Beaucoup d’entre eux étaient musiciens amateurs ; ils m’assuraient qu’en cas d’échec, je retrouverais ma place auprès d’eux.
Le temps passant, le contact avec Jennie Tourel a pris de plus en plus d’importance pour vous.
Après le cours, la musique restait omniprésente : on assistait à un récital de musique de chambre chaque vendredi soir et à de grands concerts chaque week end. A la fin des neuf semaines, c’est elle qui m’a proposé de continuer à être mon professeur à la Juilliard School de New York. Je n’ai pas hésité à saisir cette chance.
Au delà de son enseignement, vous avez appris d’elle une certaine ferveur vis-à-vis de la musique ?
Oui, certainement, la ferveur. Elle avait aussi une passion pour les langues. A sa suite, j’ai chanté dans beaucoup de langues. Chanter dans une langue, c’est pour moi allier une musique avec la musique de la langue.
Vous souvenez-vous de vos premières émotions en montant sur scène ?
Quand j’étudiais à Juilliard school, j’ai donné des concerts dans les écoles des ghettos du Bronx et de Brooklyn ; ce fut le public le plus difficile de ma vie car ces jeunes ne m’avaient pas demandé de venir ! Ils m’ont appris comment se crée ou non la relation. entre l’artiste et le public. Ces quartiers ont été la découverte pour moi d’un monde sordide de béton. Ce n’était pas facile d’y chanter Schubert ou Debussy. Je chantais 45 minutes, puis j’expliquais un peu ce que je faisais, pour 50 dollars. J’ai appris là-bas quelque chose de fondamental : ce n’est pas nécessaire que le public ait une connaissance préalable, une formation en musique. C’est par ma relation avec la musique que j’ai retenu l’attention de ces enfants.
Suzanne, c’est le premier rôle que vous avez interprété dans "Les Noces de Figaro" de Mozart , puis repris ensuite de nombreuses fois. Parlez moi de ce rôle.
C’est une chance de pouvoir interpréter un rôle d’opéra aussi complet ; à l’opéra on doit souvent inventer ce qui n’est pas dans le livret. Suzanne est une femme simple qui a une forte personnalité ; elle sait exactement ce qu’elle veut, je peux m’identifier à elle. Elle aime Figaro, elle le veut. La première fois que je l’ai interprétée, c’était à Berlin avec Dietrich Fischer-Dieskau et sa femme, Julie Barili comme comtesse, José Van Dam comme Figaro. Le personnage de Suzanne permet un jeu à beaucoup de niveaux, par exemple dans le duo du 3ème acte : elle a préparé cette lettre avec la comtesse et l’a envoyée. Elle joue un jeu dangereux et elle le sait ; on a très peu de temps pour faire sentir au public la subtilité du personnage.
Vous vous produisez parfois dans des lieux vastes ; n’êtes-vous pas alors gênée par certaines conditions acoustiques ? Vous dites souvent que vous préférez l’intimité des lieux fermés, des églises ; n’y a t il pas des oeuvres intimes qui ne supporteraient pas d’être interprétées en plein air ?
Cela dépend. Par exemple à Orange, pour 10.000 personnes, c’est formidable. De plus le mur aime ma voix, il la porte ! J’ai chanté Carmen et Turandot à Orange. En revanche, par exemple, Madame Butterfly se déroule comme une conversation intime qui exige un lieu petit. On ne fait pas non plus un récital dans un stade. On perdrait les paroles c’est à dire la poésie et le sens.
Maria Callas représente pour vous un modèle, mais n’était-elle pas aussi une diva tombée dans le business ?
J’étais dans son cours à Juilliard school qui avait lieu en public, ce qui rendait l’attention difficile. C’était une femme émouvante, seule et triste. J’étais en face d’une grande diva, que mon école était si fière d’accueillir, et je me disais : dans ce métier faut-il arriver à la fin si seule ? Elle n’a pas réussi sa vie de femme, elle aurait mérité qu’on l’aime plus pour elle-même, moins comme vedette.
Contrairement à Maria Callas, vous critiquez le système de l’opéra. Vous ne voulez pas vous y laisser prendre.
L’opéra coûte très cher. On est donc obligé d’aller vite. Interpréter un opéra en arrivant trois jours avant m’a rendue triste, pour moi, le travail n’avait pas été suffisant, par manque de temps pour des répétitions d’ensemble.
Quand on évoque votre voix, on emploie certains mots : "timbre d’opale liquide", "soprano à l’aigü souple, aérien" , "soprano au spectre étendu". J’aimerais que vous me disiez ce que vous retenez. Y a-t-il des mots qui vous touchent quand on évoque l’émotion que suscite votre voix ?
Un "spectre étendu", ça j’adore ! Oui, je suis là pour communiquer mon émotion avec une large palette.
Alors que vous êtes très célèbre comme cantatrice, restez-vous toujours attachée au jazz de votre adolescence ?
Quand j’avais 14 ans, j’ai eu ce professeur pianiste de jazz, mais je n’avais pas le droit d’aller là où il jouait. Je suis parfois gênée qu’on écoute du jazz en faisant autre chose. J’aime que le public soit attentif. Lorsque j’habitais en Suisse, mon voisin fascinait mes enfants avec ses gadgets, mais il avait surtout de fabuleuses archives de son festival de Montreux. Un soir, nous parlions de Duke Ellington et je lui disais "quel grand artiste malheureusement oublié". Il m’a proposé de faire un hommage à Duke Ellington au prochain festival et il m’a envoyé quatre cartons de disques. J’ai donc préparé le programme en retrouvant beaucoup d’airs que je connaissais ; l’idée ne m’est même pas venue que ce pourrait être un échec. Ce fut une réussite, bien que je n’avais pas alors le niveau des grandes chanteuses de jazz. J’aime le public du jazz, qui attend de moi le respect de cette musique ; pas question que je l’adoucisse en mélodie ou que je la chante à la manière d’un opéra ;.
Vous êtes donc dans chaque lieu, au service de votre art et du public qui vous écoute ; vous êtes aussi dans les combats du monde actuel. Certains artistes considèrent que c’est dans l’exercice de leur métier qu’ils servent le mieux la lutte pour un monde meilleur ; chez vous ce souci passe par un engagement explicite d’action militante dans des organisations humanitaires. Est-ce une deuxième vie pour vous ?
Pour moi c’est le même combat. Quand je chante, la musique est là pour nous rappeler que nous sommes une partie de quelque chose de plus grand que nous, que nous apercevons par une émotion du cœur qui vient de l’âme.
L’enseignement musical est très marginal dans notre système scolaire. Pourtant, les jeunes sont très sensibles à l’expression musicale. Ils sont nombreux dans votre public. Ne pourrait-on donc pas développer ce désir chez eux ? Comment le verriez-vous ?
Quand on diminue les budgets d’éducation, on paie bien plus cher ensuite en violences. Les gens pensent trop "utile" pour l’école, alors qu’il faudrait beaucoup plus de place pour éduquer tous les élèves au plaisir artistique, afin que, plus tard, après leur travail, ils puissent se mettre à un piano ou aillent chanter dans une chorale. Tout le monde a la possibilité de chanter ou de jouer d’un instrument, pourquoi pas de jouer au théâtre ? Pourquoi ne pas s’exprimer par la littérature, écrire ?