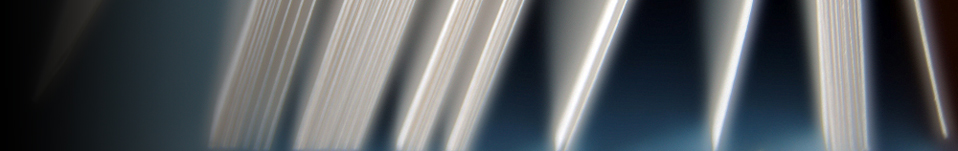Daniel Mesguich

(octobre 2001) Théatre, philosophie Vitez
Quelques extraits d’un entretien avec Daniel Mesguich
"Philosophie et théâtre sont liés dans une affinité turbulente et insistante en privilégiant l’autorité de la présence et de la visibilité", écrit Jacques Derrida. Daniel Mesguich a fait de son théâtre un lieu de résonance où on entend et on pense la philosophie en actes dialogiques en scène. On a souvent souligné le caractère baroque de son écriture scénique. Elle est surtout plurielle, complexe, liée à sa croyance qu’une infinité de personnes doit converger dans le personnage de scène pour mettre en crise le texte comme le sens.
Tous les qualificatifs ont été utilisés à votre propos ; tout et son contraire a été proclamé : "oeil sombre et talmudique" dit l’un, "visage aigu" dit l’autre, "vorace", "volubile", "nez aquilin", "large front", les descriptions stéréotypées voisinent avec les jugements. Vous êtes adulé par les uns, vilipendé par les autres, mais tous disent de vous que vous êtes un intellectuel iconoclaste qui s’est fait une personnalité originale, en sachant vous dépenser dans le travail avec une vocation têtue.Comment réagissez-vous à ces portraits souvent contradictoires ?
Je retiens surtout la contradiction ; c’est en elle-même davantage qu’en l’un quelconque de ses termes, qu’il y a, je crois, le plus de "vrai".
Cette fluidité, cette pluralité identitaire vous vient-elle de l’Algérie originelle ?
Sans aucun doute, mais tellement indirectement, déjà. J’ai quitté Alger, à un moment où la guerre, les attentats et les assassinats y semblaient naturels, à l’âge de dix ans. Ces premières années ont dû tisser des pans de moi indétramables. De mille manières, même infimes, la vie en Algérie était très différente de ce qu’on vivait en France. Un exemple parmi des dizaines : en cette "province française" encore, certes, mais lointaine, les livraisons, depuis la "métropole", des mensuels illustrés qui passionnaient le petit garçon que j’étais arrivaient - quand elles arrivaient - au petit bonheur la chance, avril parfois avant janvier, mélangeant l’ordre des épisodes des histoires "à suivre" ; j’avais pris l’habitude d’imaginer les débuts absents de ces histoires, ou de trouver un bien-fondé aux violentes ellipses et aux impossibilités logiques de ces intrigues lues au mépris de toute chronologie. Je crois qu’il reste quelque chose de cela dans mon travail : deux, trois, mille histoires en une.
Avez-vous vécu une enfance heureuse ?
Je crois pouvoir répondre oui sans hésiter. J’aimerais écrire sur mon père et ma mère. Je pense que chaque "enfant" - c’est-à-dire tout le monde ! - devrait le faire. Ceux-là auront donc été magnifiques. Ce que j’avais pris parfois pour faiblese, imperfection, aura donc été force supérieure : ce père et cette mère aimants ne m’ont jamais écrasé - c’est qu’ils étaient des enfants, eux aussi ! -, il aura fallu la mort de ma mère pour que je le comprenne. Mon père était boucher ; et du côté maternel - ma mère était elle-même, pourtant, assez cultivée et curieuse de tous les livres - on vendait des tissus. Mais c’était un milieu plus "philosophique" qu’on ne l’imaginerait. "Dieu", "raison", "au-delà", "esprit", émaillaient tous les discours de mon père, et si je laissais un livre par terre, lui, que je n’ai vu lire que très rarement, le ramassait pour le poser sur une table en lui faisant un petit baiser respectueux : c’était "de l’écriture". A Alger, je vivais la main dans la main de ma mère : le présent - le présent-même - avait un goût de passé, une douce saveur de souvenir. Débarquant à Marseille à la fin de la guerre d’Algérie, en pleine année scolaire, tout a changé dès mon premier jour d’école : ma mère, qui s’était mise à chercher du travail, m’avait dit, ne pouvant pas venir me chercher, de rester à la cantine ; mais elle avait oublié de me laisser le franc correspondant au prix du repas. A 11h30, je suis sorti de l’école, et j’ai erré dans les rues. Pour la première fois, j’étais seul et j’ai senti le présent - le présent vraiment - sur ma peau. Il me sautait au visage. Je venais de grandir d’un coup. Tout devenait possible.
Quand on parle de vous on évoque facilement l’élève d’Antoine Vitez. Curieusement, vous avez peu écrit à propos de Vitez dont l’enseignement dut être fondateur pour vous. Bien sûr, Vitez est le symbole d’un théâtre qu’on pourrait, en face de vous, qualifier de puritain ou de janséniste, alors que le qualificatif qui convient le mieux à votre art est peut-être celui de "baroque" ; flamboiement d’insolence baroque, dirais-je, crépitement d’inventions étincelantes. Pourtant vous avez beaucoup appris de lui .
Vitez a été mon professeur d’envol. Il risquait sans cesse, et réussissait, entre le théâtre et la "pensée" les plus folles, les plus ludiques connexions. Il a lancé les ponts les plus improbables - tellement que ces deux rives ont fini par se rapprocher jusqu’à me dévoiler qu’elles n’étaient qu’une seule - entre, d’une part, la soif de penser et d’agir du jeune "révolutionnaire" que j’étais, et d’autre part l’art du théâtre, que le jeune acteur que, je ne savais pas trop pourquoi, je voulais être aussi, ne parvenait pas à imaginer autrement que comme la production très artisanale d’une corporation assez fermée, un peu embourgeoisée, un peu vulgaire, touchante et cynique à la fois - et vaine. Vitez m’a recousu ; il m’a fait don du fil d’or par lequel les ailes tiennent au corps. C’est vrai, j’avais de son vivant, une certaine pudeur à me dire son élève. D’autres étaient plus proches de lui que moi. Pourtant toutes mes mises en scène s’adressaient à lui, le père en théâtre, que j’avais autant envie de contester que de serrer dans mes bras ... Cet excitateur d’intelligence inventait sans cesse des formes, des codes nouveaux. Cela n’est pas qu’anecdotique : combien de spectacles "révolutionnaires" qui se jouent comme on joue au boulevard, discréditant d’emblée, par leur "forme" convenue ou peu pensée, le "contenu" qu’ils veulent clamer !
Vitez voulait n’exclure personne du théâtre, d’une certaine façon que résume bien cette formule "le théâtre élitaire pour tous".
Oui. Vilar était un peu son modèle, ou plutôt l’un de ceux (il y avait aussi Aragon, dont il avait été, un temps, le secrétaire) à qui, par delà la mort, il fallait rendre des comptes, avec qui il fallait régler des comptes, aussi. Le malheur du "théâtre populaire", c’est qu’aujourd’hui même le plus crétin et le plus vulgaire des "décideurs" de télé emploiera, pour justifier ses piètres programmations, ce mot de "populaire". "Populaire" est devenu le synonyme pudique du mot, peu commercial en soi, de "commercial". "Elitaire pour tous" signifiait - signifie, car cela est toujours au programme, au mien en tout cas - que, sans en rabattre jamais sur la volonté affirmée de n’exclure personne, il faut pourtant tenter les choses les plus belles, les plus difficiles peut-être, en se fondant sur cette idée que, si la masse du public est toujours paresseuse ou tire vers le bas, chaque spectateur, au contraire, chaque lecteur, chaque "chercheur", est toujours capable, dans sa solitude, de s’ouvrir, de se dépasser. Il faut se fonder sur cette confiance en lui, et en nous, que c’est la confrontation avec ce qu’on viendra lui proposer qui le transformera ; que ce sont nos propositions elles-mêmes qui pourront le rendre apte à entendre ... de telles propositions, précisément. Car c’est à un public en devenir qu’il faut s’adresser, et non, comme le fait le théâtre commercial, au public tel qu’il est, dans l’état où il est. "Commercial" signifie qu’on s’adresse au présent comme s’il était un passé, et devait le rester. "Elitaire pour tous", qu’on s’adresse au présent comme on s’adresserait à un à-venir ; qu’on s’adresse au dépassement, à la promesse.
"Le Soulier de satin", les pièces de Kalisky, "Tombeau pour 500 000 soldats" de Guyotat, ont été montés avec une rigueur exceptionnelle par Vitez et une volonté d’épurer toute scorie, à l’inverse de votre surabondance de significations. En face de vos spectacles, on se demande toujours quelle partie du système de signes on va savoir percevoir.
J’aime ce qui est complexe, comme, je ne sais pas, Shakespeare, la vie... Le simple, dont on nous vante sans cesse la supériorité en art, me paraît lisse, compact, forteresse imprenable. Le simple m’exclut, je glisse sur ce lisse : le complexe au contraire, pour peu que je cherche un peu, m’offrira toujours une entrée, ici ou là, entre deux de ses plis. Au fond, c’est le simple, à moins qu’on ne le divise encore et encore, qui me paraît bien compliqué ; quand c’est le complexe souvent, je l’avoue, qui me paraît plutôt simple. Vitez cherchait, sinon le simple, du moins le un, le net, l’unique. J’aime, moi, le bouillonnement, le débordement, la multiplicité, et que le centre ne soit jamais où on l’attend. Non pas l’Etre, mais les lettres ; ou bien, là-haut dans le ciel, des lettres comme Etre, peut-être..., qu’en pensez-vous ?
Votre livre, L’Eternel Ephémère, propose un mariage entre le texte éternel auquel on peut presque dire que vous croyez et une image éphémère que vous aimez voir surabonder.
Un équilibre plutôt qu’un mariage, une élasticité, une tension ; une ouverture et une réouverture, inlassablement, de leur différence. Mais ce que j’aime avant tout c’est, plutôt que les images, la lecture, cet acte. Je n’aime pas le "théâtre d’images", où celles-ci semblent tenir toutes seules, pleines comme des totems. Les images, je ne les aime que comme des effets de lecture, des appoints ou des écrins, toujours provisoires, comme une vague ou une fumée, pour mieux soulever ou révéler la fulgurance d’un sens dans la lettre. Elles peuvent dé-tisser un texte, le retisser sous un jour nouveau, mais ne sauraient pour moi en remplacer les fils.
Vous avez monté à l’Athénée Louis Jouvet Le Diable et le Bon Dieu de Jean-Paul Sartre. Aujourd’hui, cette pièce tourne dans le pays. Elle a été créée en 1951 au Théâtre Antoine par Louis Jouvet lui-même avec une formidable distribution : Pierre Brasseur, Jean Vilar et Maria Casarès. Vous le reprenez à une époque où la lecture de Sartre n’a plus le même impact.
J’aime Sartre. Je l’aime toujours. Il m’a, plus jeune, beaucoup donné, et même si, depuis, j’ai rencontré des écrivain et des penseurs qui m’ont plus ou moins éloigné de lui, je n’arrive pas à être tout à fait ingrat. J’ai voulu lire Le Diable et le bon dieu comme un classique, et non comme l’exposition dialoguée des thèses philosophiques et politiques d’un philosophe et d’un homme politique encore présent, avec qui l’on pourrait être d’accord ou pas. J’ai voulu le lire comme le texte retrouvé d’une légende ancienne, géniale, flamboyante et naïve, et dont la naïveté-même appellerait l’intelligence et l’analyse. Sartre n’est plus notre contemporain, c’est sa chance, et c’est la nôtre.
On peut rappeler l’argument, le drame d’un homme qui veut choisir librement le Mal, puis le Bien, opter pour le Diable, puis pour le Bon Dieu, mais éprouve la vanité de ce choix dans la mesure où il est gratuit et opéré dans la solitude en dehors de la communauté humaine. Dans l’Allemagne de la renaissance, en proie à la guerre des seigneurs et des paysans opprimés, Goetz, un chef de guerre, fils bâtard d’une mère noble et d’un paysan, après avoir décidé de faire le mal, décide de faire le bien. Il organise une communauté modèle, la cité du soleil, autour de la loi de l’amour.
"La nuit, c’est toi, hein ?" demande Gozt à Dieu, avant de saisir qu’Il est cette Brêche dans la porte, ce Trou dans la terre, l’Absence, le Silence, etc. Et Gotz choisit le combat des hommes. "Judaïsme universalisable", je retiendrais ces deux mots.
Peut-on un instant imaginer que vous redeveniez élève ? Quelles sont vos envies de théâtre aujourd’hui ?
J’espère que je suis toujours un élève ! Je ne dis pas cela par coquetterie. Simplement, maintenant que je suis plus grand, j’aide en moi l’enfant que j’étais à faire ce qu’il ne pourrait pas faire sans moi. Ma vie sera trop courte pour réaliser toutes les pièces auxquelles je rêve. Borgès évoquait le livre qui est dans sa bibliothèque qu’il n’ouvrirait plus jamais, la porte qu’il ne pousserait plus jusqu’à la fin des temps, la rue de Buenos Aires où il ne marcherait plus. "Cet été j’aurai cinquante ans, la mort me dégrade incessamment", ajoutait-il. Moi aussi. Il est pratiquement programmé que je ne mettrai pas en scène Agrippine de Cyrano de Bergerac, par exemple, et ça me fait mal. Mais j’aimerais mettre en scène Rouen, la trentième nuit de mai 31 de Hélène Cixous, qui est à mes yeux le plus grand écrivain de théâtre d’aujourd’hui.